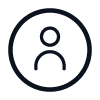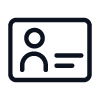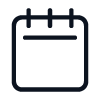3903
Contributions
Contributions

9674
Participants
Participants

6583
Likes
Likes

194603
Sondages
répondus
Sondages
répondus

Ici, nous construisons SNCF Connect avec vous !
Vous avez un avis, des idées plein la tête ? C’est ici que vous pouvez les exprimer !
Connect & Vous, c’est un espace d’échange et de co-création pour imaginer ensemble la mobilité de demain.
Découvrez en avant première les projets, partagez vos idées et réagissez à celles des autres membres de la communauté.
Prenez part à l’aventure, devenez membre de la communauté Connect & Vous et améliorons ensemble SNCF Connect. Inscrivez-vous en 2 minutes !
27 févr. 2024
19 févr. 2024
01 févr. 2024
24 janv. 2024
* informations obligatoires
Un email vient de vous être envoyé pour valider votre inscription !
Cliquez sur le lien dans cet email pour activer votre compte.
Pensez à vérifier dans vos spams si vous n'avez pas reçu l’email.
Cliquez sur le lien dans cet email pour activer votre compte.
Pensez à vérifier dans vos spams si vous n'avez pas reçu l’email.
Nous avons essayé d'envoyer un email pour valider votre inscription, il semblerait qu'il y ait eu une erreur dans sa réception !
Assurez-vous que l'adresse email suivante est correcte : .
Si besoin, veuillez contacter le support à l'adresse dl_communaute@connect-tech.sncf pour vous aider à vous inscrire.
Assurez-vous que l'adresse email suivante est correcte : .
Si besoin, veuillez contacter le support à l'adresse dl_communaute@connect-tech.sncf pour vous aider à vous inscrire.
Le caractère saisi n'est pas acceptable pour le pseudo, veuillez le changer svp.
La séquence de caractère ?? n'est pas autorisé dans ce champ. Veuillez ne pas l'utiliser svp.
La séquence de caractère ?? n'est pas autorisé dans ce champ. Veuillez ne pas l'utiliser svp.
Le pseudo semble être un numéro de téléphone. Veuillez choisir un pseudo différent
Ce pseudo est trop petit, il doit être d'au moins 3 caractères.
Ce pseudo est trop long, il ne peut contenir que 30 caractères au maximum
Ce pseudo est déjà utilisé. Veuillez saisir un nouveau.
Le pseudo est identique à l'adresse email. Pour des raisons de sécurité, veuillez choisir un autre pseudo.
Votre mot de passe doit comporter un minimum de 12 caractères, se composer de chiffres et de lettres et comprendre des majuscules/minuscules et un ou plusieurs caractères spéciaux.
Votre mot de passe doit contenir au minimum :
12 caractères
1 chiffre
1 lettre minuscule
1 lettre majuscule
1 caractère spécial
* informations obligatoires